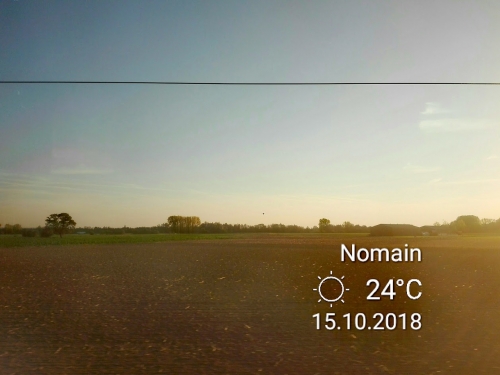C’était un carré, ce qu’on appelle un carré semble-t-il dans le jargon du rail, et j’avais posé mon sac à dos en face de moi. Je lisais les dernières scènes d’un drame philosophique qui n’avait rien de théâtral, ou dont la théâtralité paraissait artificieuse, mais peu importe, c’était un dialogue philosophique du temps présent, un Cratyle et une Diana reclus dans la spirituality room d’un aéroport fin-du-monde, un bouddha souriant au-dessus d’un distributeur de boissons, le plafond s’effondrant par endroits. L’un prétendait breveter le langage sous forme de forfait langage, de crédit langage et d’abonnement à la logosphère, convaincu du devenir chose des mots. L’autre déplorait le devenir aphrodisiaque de la civilisation et tentait de poursuivre le vent pour l’exposer en faisceaux de couleurs et en nappes d’ondes dans une galerie. Ils s’étaient aimés il y a quinze ans et s’étaient retrouvés fortuitement dans cet aéroport. C’est Diana qui avait baptisé Cratyle, car il s’appelait Jason avant leur rencontre. Cratyle, au XXIe siècle, possède un ordinateur et fomente un gros coup financier, mot de passe DIANA. Tandis que Cratyle gît inconscient, Diana fouille dans son ordinateur et envoie sans état d’âme le dossier du brevet à ses amis linguistes, artistes et bègues.
Le train s’arrête à Orchies, une jeune fille se penche vers moi, me demandant si la place est libre. Comprenant son embarras, je lui dis que le magazine posé sur le siège n’est pas à moi. Elle le déplace dans l’angle opposé au mien dans ce carré où j’étais seul depuis le départ, s’assied à côté de moi, préférant, comme la plupart des voyageurs, être dans le sens de la marche. Nos coudes se gênent sur l’accoudoir, je me replie contre la fenêtre. À Templeuve, une autre jeune fille s’installe qui mange et boit aussi discrètement que possible, puis une autre encore qui coince le magazine verticalement sur la grille du climatiseur car il n’y a plus guère de siège disponible. Je feuillette le magazine, Lille durable, tous mobilisés, un éditorial de la mairesse, Agir ou périr, et, page après page, Faites germer vos idées vertes, des Bulles à flotter, Les Lillois en quête de jardins, La rue, ça se partage, Les fêtes aussi peuvent être durables, La ville chasse le gaspi, Le labo du zéro carbone, autant de titres qui auraient réjoui Philippe Murray. « Le monde est détruit, il faut le versifier », écrivait-il.
Comme j’arrive au bureau, je suis témoin d’une séparation bruyante en pleine rue, qu’elle nique sa race, sale pute, la jeune fille répondant sur le même ton puis traversant la rue et marchant devant moi, rejointe par un vieil homme barbu et chevelu qui lui aussi a assisté à la scène, au costume aussi dépareillé que défraîchi. Ils discutent, je suppose qu’elle explique la situation à cet inconnu qui a manifesté de la compassion. Je ne suis pas assez rapide pour photographier le dos d’un passant qui affiche en lettres capitales SAN ANTONIO. Mes semblables me réjouissent, je vois bien que tout cela échappe aux verbosités médiatiques et politiques, et que l’on ferait mieux de se laisser vivre au hasard et selon des affinités animales. Il fait drôlement chaud aujourd’hui, octobre a les oripeaux de l’été. Rien n’est normal ces temps-ci. Rien ou presque n’a été bon depuis ma naissance, non que mon sort tout particulier ait un quelconque intérêt en l’occurrence, mais, tordons les temps verbaux, en 1975 tout serait bientôt fichu, certains l’avaient écrit, le fameux Rapport sur les limites de la croissance, 1972, éditions Pisser dans un violon.
Ma pause, je la fais à la Fnac, je cherche un livre, Défaire la tyrannie du temps, mais je repars avec Une histoire environnementale de l’humanité. Je me plonge dans les premières pages en attendant un serveur et un café qui ne viendront jamais. Des macaques se baignent dans l’eau chaude au tréfonds des Alpes nippones, la description d’une fausse nature, « anthropisée, façonnée de la main de l’homme, un raccourci saisissant de ce qu’est notre planète aujourd’hui ». Marchant dans les rues de Lille, je prends en photo une vieille enseigne bien connue. Ici c’était une librairie, des livres anciens, des livres choisis, une vieille dame au milieu de ses trésors. Je m’arrêtais souvent pour examiner cette vitrine, mais j’achetais plutôt mes vieux livres dans des bouquineries où je pouvais circuler à loisir sans être intimidé. C’était les années 90, je n’avais pas encore de téléphone, un ordinateur mais pas internet, il me semblait que chaque livre découvert puis ouvert, que l’odeur âcre des papiers du XIXe siècle me reliaient à un lecteur du passé, à une époque et à un rapport au monde particulier. Aujourd’hui, derrière l’antique vitrine, l’espace est dégagé, des écrans géants scandent le nom d’une marque coréenne. Il fait 22 degrés, tout va bien.
Je quitte le bureau à 17 heures après avoir parcouru un article sur un projet de loi, quelque chose comme les habits neufs de l’empereur. Dans la cage d’escalier j’appelle mon amoureux. Il est en Suisse, j’ai vu sur une photo le panorama qu’il peut admirer depuis la fenêtre de sa chambre. Dans une heure, il commencera à répéter, chanter, faire vibrer ses cordes vocales en s’ajustant aux fréquences des autres chanteurs. Je ne connais rien de plus extraordinaire que cette capacité à atteindre la perfection technique tout en la dissimulant par la singulière complexion des chairs et des nerfs.
Dans le train, mon voisin me gêne, histoire de coudes encore, de corpulence. Il lit Muhammad, vie du prophète. Il fait 25 degrés, c’est un vieux train sans climatisation, ma fenêtre ne s’ouvre pas.
Je m’installe plus loin, des places se sont libérées. Là j’ai de l’air. De l’autre côté de l’allée, un homme lit le Droit civil des biens.
Mes semblables me réjouissent.